 L'Institut Français de Florence
L'Institut Français de Florence
Valery Larbaud et Louis Chadourne se rencontrent à Florence en 1912. Valery Larbaud est venu en Italie pour effectuer des recherches sur Walter Savage Landor, écrivain britannique ayant vécu à Florence. L’Institut Français de la ville sera durant son séjour une sorte de « quartier général » où se construiront de solides amitiés, dont celle avec Chadourne, qui donne des cours à l’Institut depuis 1909.
L’Institut Français
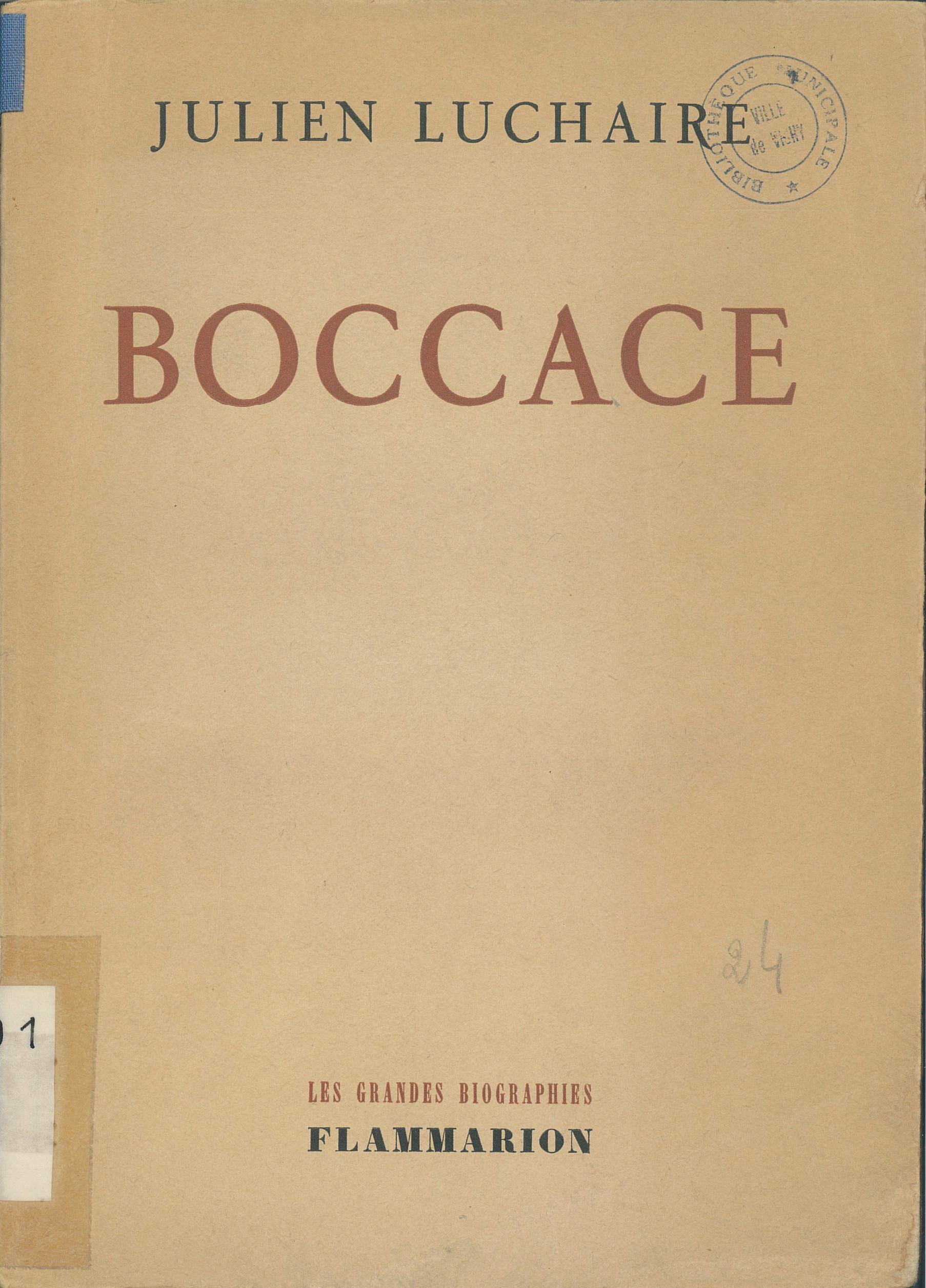 L’Institut Français de Florence est à l’origine du réseau des Instituts Français qui existent aujourd’hui partout dans le monde. Il a été fondé en 1907, avec l’aide de l’université de Grenoble, par l’écrivain Julien Luchaire, auteur d'essais, romans, pièces de théâtre, et spécialiste de Boccace, l'auteur du Décaméron.
L’Institut Français de Florence est à l’origine du réseau des Instituts Français qui existent aujourd’hui partout dans le monde. Il a été fondé en 1907, avec l’aide de l’université de Grenoble, par l’écrivain Julien Luchaire, auteur d'essais, romans, pièces de théâtre, et spécialiste de Boccace, l'auteur du Décaméron.
L’Institut propose des cours et accueille parmi ses professeurs deux jeunes spécialistes de l’Italie qui vont se lier d’amitié avec Valery Larbaud : Benjamin Crémieux et Louis Chadourne.
Chadourne est arrivé à Florence en 1909, après avoir obtenu une bourse pour être lecteur à l’Institut. Julien Luchaire dit de lui dans ses mémoires qu’il « était difficile de résister à la grâce de sa personne physique et de son esprit. » (1). Outre ses cours, Chadourne va s’occuper avec Benjamin Crémieux de deux revues publiées par l’Institut, le Bulletin Franco-Italien et France-Italie, dans laquelle il publiera certains de ses poèmes.
L’arrivée de Valery Larbaud
Larbaud s’installe à Florence en avril 1912. Il y retrouve André Gide, qui écrit dans son journal le 8 mai : « Quelle ville que Florence !!! […] Larbaud vient me rejoindre et dérange passablement mon travail ; mais si gentil ! Et sa conversation, de quel intérêt ! ».
Sur la recommandation de Gide, il est introduit à l’Institut Français, qu’il décrit ainsi à Léon-Paul Fargue dans sa lettre du 1er juin : « J’ai trouvé ici quelques Français intéressants, à l’Institut Français, fondé par J. Luchaire […] : un jeune poète nommé Louis Chadourne, et un universitaire très peu universitaire, Crémieux. » Il ajoute : « Je pense que je reverrai les Français de l’Institut à mon retour en France. ». Pour sa part, Julien Luchaire parle de « Valery Larbaud, promenant sa nonchalance aiguë, son ingénuité malicieuse… ». (2)
Larbaud éprouve initialement un sentiment de liberté assez nouveau pour lui, comme il l’écrit à Marcel Ray dans une lettre du 9 mai : « C’est la première fois qu’il m’est permis de ne pas rentrer en France tous les deux mois, et j’en profite pour me bourrer de lectures et de notes. […] Oui, je travaille beaucoup. Grandes ambitions. » Il fréquente assidûment les bibliothèques et services d’archives, mais rencontre quelques difficultés : « Il y a à la tête de ces Archives un petit bureaucrate grincheux et flemmard, qui n'aime pas se déranger, et qui m’a prétexté toute espèce d’obstacles pour m’empêcher de voir les plus importants documents. », écrit-il agacé à Fargue.
Il s’abonne aussi pour un mois au Cabinet scientifique et littéraire Giovan Pietro Vieusseux, bibliothèque hébergée au sein du Palais Strozzi :
https://www.vieusseux.it/cronologia-del-gabinetto-vieusseux/sfoglia-la-cronologia/1908-1917/
(Chadourne, lui, s’y abonnera en 1913.)
Ses liens avec l’Institut et Julien Luchaire lui permettent finalement d’accéder aux documents convoités, et il prolonge son séjour jusqu’en juillet, quittant Florence pour Côme puis la France. Il écrit à Marcel Ray le 6 juillet : « Florence devenait intolérable, malgré la compagnie de [Augustin] Renaudet qui m’a fait connaître tous les chiassi les plus sales et les bouges les plus immondes de la ville. » Dans une lettre à Fargue datée de juin, Larbaud racontait d’ailleurs qu’il avait traversé une « grande période de faiblesse. […] Tout semblait arrêté chez moi, même le raisonnement. ».
Il semble que cet état de fatigue, au moins psychologique, soit partagé par Chadourne. Durant l’été celui-ci écrit à Larbaud depuis Brive, où il est en vacances : « Reviendrez-vous à Florence en automne ? Je le souhaite. Un mot de vous me fera grand plaisir. Je suis très mal équilibré moralement ces jours-ci. » (Lettre du 20 juillet 1912)
Fin septembre, Larbaud se réinstalle tout de même en ville. « J’ai commencé […] à fréquenter la Biblioteca Nazionale […]. Mais pour m’installer, je n’ai pas eu la main heureuse. Voulant dépenser le moins possible je me suis logé dans une sorte de pension de quatrième ordre (3) où j’ai été si mal qu’au bout de huit jours j’ai cherché un autre logement. Justement en rentrant de cette chasse, j’ai trouvé la porte de ma pension fermée : l’huissier venait de tout saisir. Le soir même j’étais dans la chambre d’où je vous écris ; où, pour deux francs de plus par jour, j’ai toutes sortes de commodités, et une vue admirable sur l’Arno, les vieilles maisons du quartier S. Jacopo, la Piazza Michelangiolo, Samminiato, et la terrasse de la forteresse du Belvédère. […] Peu à peu tous les gens de l’Institut sont rentrés. » (Lettre à M. Ray du 10 novembre 1912)
Larbaud est en fait devenu le voisin de Chadourne : tous deux habitent Lung’Arno Acciaioli, Chadourne au n°2 et Larbaud au n°16. Ils continuent de se voir très régulièrement, comme en atteste une lettre de Larbaud à Léon-Paul Fargue : « J’espère avoir demain le livre que tu envoies à Chadourne. Il sort d’ici, emportant le dernier n° de la N.R.F. qui contient ton merveilleux salon [un texte de Fargue]. Tu ne peux pas te figurer avec quel plaisir je l’ai lu. » Fargue et Louis Chadourne se verront par la suite à Paris, lors de la convalescence de Chadourne après sa blessure de guerre en 1915.
 https://www.gallery.ca/collection/artwork/florence-lungarno-acciaioli-with-ponte-vecchio
https://www.gallery.ca/collection/artwork/florence-lungarno-acciaioli-with-ponte-vecchio
Retour en France
Valery Larbaud séjourne dans la cité toscane jusqu’à la fin de l’année 1912, date à laquelle il emménage à Paris dans un appartement rue Octave Feuillet. Louis Chadourne le suit de peu, retournant à l’université de Grenoble pour y préparer l'agrégation, éprouvant une nostalgie certaine pour l’Italie qu'il confie à l'écrivain vichyssois dans une lettre de janvier 1913 : « Je vous vois à la table du Di Consultazione. Et le thé à 4 h ½. […] J’envie cette existence florentine qui a été la mienne. Là-bas, il y tant de choses que l’on sent belles autour de nous. L’on croit ne plus s’en apercevoir. Mais elles sont belles malgré tout. Et cela fait quelque chose, de la paix en nous. ».
------
(1) RENARD Isabelle, L’Institut Français de Florence (1900-1920) …, p. 145. https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2001_ths_291_1_7205
(2) Cité dans RENARD Isabelle, ibid., p. 273.
(3) Une lettre à Léon-Paul Fargue du 3 octobre indique comme adresse : 30 via Montebello.


